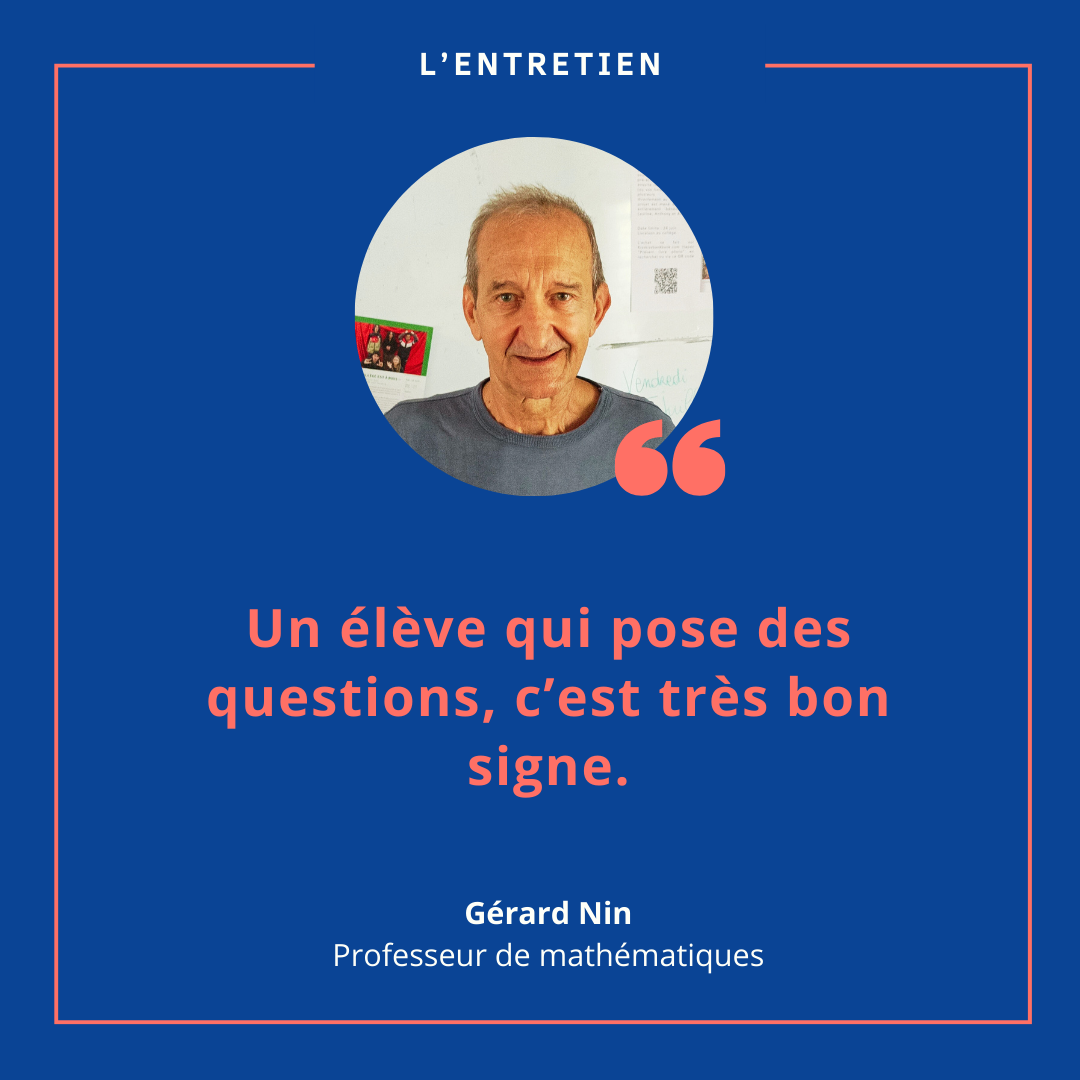
« Un élève qui pose des questions, c’est très bon signe »
L’infini est un concept mathématique. C’est aussi le symbole de la carrière de Gérard Nin qui, après avoir donné des cours à l’université et formé des futurs professeurs de collège et de lycée, continue de retrouver les élèves de l’Institut Louis Germain, campus après campus. Jusqu’à quand ? Jusqu’à l’infini et au-delà. Entretien.
Qui êtes-vous Gérard Nin ?
Je suis professeur de mathématiques, agrégé de maths. Avant la retraite, j'étais maître de conférence à l'université. J’ai aussi travaillé dans les IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) et les ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) qui s’appellent aujourd’hui les INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation). Je formais les futurs professeurs de collège et de lycée. À ce titre, j'étais en lien direct avec l'enseignement secondaire, ses programmes, ses élèves, puisque j'allais faire des observations dans les classes pour conseiller les jeunes collègues.
Comment vous êtes-vous retrouvé devant les élèves de l’Institut Louis Germain ?
Il y a sept ou huit ans, monsieur Puel m’a présenté le projet : accompagner de bons élèves des quartiers difficiles pour qu’ils puissent exploiter leurs capacités, envisager de faire des études supérieures et avoir un autre avenir. Ça m’a plu et ça continue de me plaire.
En plus, on a eu de belles réussites : des élèves qui font des classes préparatoires et qui intègrent de grandes écoles… On les revoit et c’est agréable de se dire qu’on a eu un impact positif.
Vous êtes donc là depuis le début de l’aventure. Quel souvenir en gardez-vous ?
Au départ, on était assez nomade. On a organisé des campus à l’IUFM, sur le site de l’université Saint-Charles, à Luminy… Il y avait plusieurs cars qui allaient chercher les élèves pour les déposer en plein milieu de la Cannebière ! C’était un sacré bordel (rires).
On est mieux ici, au collège Jacques-Prévert, un endroit agréable où l’on est très bien accueilli, avec le métro tout à côté.
Quelles sont les différences les plus importantes par rapport aux conditions habituelles d’enseignement ?
D’abord, on a plus de liberté par rapport au programme. Ensuite, on a moins d’élèves que dans les classes de collège et de lycée. Enfin, on a affaire à des élèves volontaires. Volontaires pour être là et volontaires dans l’absolu, c’est-à-dire qui ont la volonté de réussir.
Y a-t-il des exceptions à la règle ?
C’est rare, mais il y a parfois des récalcitrants. Je leur dis : « Écoutez, si vous êtes là, a priori, c’est que vous l’avez voulu. Moi, par exemple, quand j’étais élève, je crois que je n’aurais jamais accepté de venir en cours pendant les vacances... À partir du moment où vous avez fait ce choix, il faut vous comporter de manière cohérente. » En général, il n’en faut pas plus pour qu’ils se remettent le nez dans le guidon.
Certaines méthodes pédagogiques mises en place lors de vos cours ont-elles particulièrement porté leurs fruits ?
Ma petite originalité, c’est que je suis engagé dans une expérience d’enseignement qui privilégie la modélisation, c’est-à-dire comment on utilise les mathématiques dans différents domaines d’application.
En plus du programme traditionnel, je fais faire aux élèves des exercices de modélisation, un peu comme ceux que l’on retrouve dans les évaluations internationales PISA, TIMSS et autres. Au passage, si les élèves français ont des résultats médiocres à ces évaluations, ce n’est pas parce qu’ils sont moins intelligents que les autres – bien au contraire – mais plutôt parce qu’ils sont moins souvent exposés à ce genre d’exercices que leurs petits camarades des pays anglo-saxons, par exemple.
Au début, ils sont un peu déconcertés, mais ils prennent très vite le pli.
Selon vous, quels bénéfices les élèves retirent-ils de leur participation aux campus ?
Ils travaillent plus et dans des conditions qui les mettent à l’aise : pas de notes, pas de classement, pas de conseil de classe pour passer dans la classe supérieure. Cinq campus de vingt-quatre heures, ça fait cent-vingt heures de cours par an. Ce n’est pas rien !
Ils ont aussi la possibilité d’intervenir plus facilement car ce sont des groupes d’une quinzaine d’élèves. Il n’y a pas de phénomène d’autocensure : on n’hésite pas à lever la main pour interrompre le cours quand on n’a pas compris. Mes collègues et moi, on leur répète qu’ils peuvent poser toutes les questions qu’ils veulent. On est là pour leur répondre. C’est une ambiance de travail qui favorise les échanges.
Campus après campus, ils croisent différents styles d'enseignants. Ça leur permet de faire la part des choses entre les mathématiques et la manière dont l’enseignant fait le média entre les deux. C’est enrichissant.
J’ai l’impression que les échanges avec les élèves sont au cœur de votre enseignement. Vous confirmez ?
Poser des questions est un critère essentiel pour l’efficacité de l’apprentissage. Un élève qui ne pose aucune question, c’est très mauvais signe. En général, ça marque une absence d'intérêt ou un manque de confiance.
Je leur dis souvent que l’attitude normale dans un cours de maths, c’est d’écouter le prof en se demandant s’il n’est pas en train de raconter quelque chose de bizarre. Si c’est le cas, il faut intervenir. Le prof m’apprend quelque chose de nouveau, et je vois comment ça se concilie avec ce que je sais déjà.
Un élève qui pose des questions, c’est très bon signe. Parce que le prof va très rapidement lever les apparentes contradictions.
Quelle vision avez-vous du système éducatif français et de la manière dont on enseigne les mathématiques ?
Il est loin d’être aussi peu performant que ce que prétendent parfois les médias, notamment sur la base des résultats aux évaluations internationales. Cela dit, il y a peut-être une certaine crainte des innovations. Au niveau de l’enseignement des mathématiques, on est très focalisé sur la démonstration des résultats. C’est bien, mais on pourrait aussi s’ouvrir à d’autres façons de faire. Au Québec, par exemple, ils passent beaucoup plus de temps à développer les exemples et les applications qu’à prouver leurs résultats.
Une étude de l’université d’Oxford, publiée en 2021, conclut que ne plus étudier les mathématiques affecterait le développement cognitif des adolescents de 16 à 18 ans. Comment est-ce que les maths participent à structurer l’esprit et la pensée des adolescents ?
En maths, le choix des mots est extrêmement important. Il faut être précis. Un cercle et un disque, ce n’est pas pareil. Un cercle, c’est une courbe. Un disque, c’est une partie du plan.
Et puis le raisonnement déductif, en maths, est très serré. Je fais ci, car c’est justifié par ça. Il faut toujours donner une preuve, justifier. C’est au cœur des maths. Savoir déduire, c’est très utile dans la vie.
J’ai l’impression qu’il y a un contraste entre les effets de la réforme du lycée (disparition des maths du tronc commun, baisse du nombre d’heures), même corrigée, et l’enthousiasme des élèves de l’Institut pour les mathématiques. Comment l’expliquez-vous ?
La France est un vieux pays qui a une culture beaucoup plus littéraire que scientifique. On le retrouve parfois dans les politiques qui sont menées. À part Valéry Giscard d’Estaing, tous nos présidents étaient plus littéraires que scientifiques. Il ne faudrait pourtant pas vider les filières scientifiques : les directeurs des écoles d’ingénieurs affirment qu’on manque d’à peu près 50 000 ingénieurs par an en France.
Cela dit, vous avez raison, au niveau des élèves de l’Institut Louis Germain, il n’y a aucun rejet des maths.